
Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail : la CFTC appelle à changer d’approche
La prévention n’est pas un supplément d’âme : c’est le cœur du travail
Le 28 avril dernier, la CFTC a tenu à rappeler une vérité simple mais essentielle : la prévention ne doit plus être perçue comme un élément secondaire, une mesure correctrice une fois le mal fait. Elle doit au contraire être pensée en amont, comme un fondement de l’organisation du travail. L’ANI du 9 décembre 2020 avait d’ailleurs posé les bases de cette ambition, en affirmant la priorité donnée à la prévention au plus près des réalités de l’entreprise. Pourtant, la loi Santé Travail de 2021 n’a pas su concrétiser cette orientation. Pour la CFTC, elle a manqué l’essentiel : inscrire la prévention dans les pratiques, dans la culture de travail, pas seulement dans les textes.
Notre organisation le réaffirme : adapter le travail à l’humain, et non l’inverse, doit cesser d’être un principe abstrait pour devenir une exigence quotidienne. Ce n’est pas aux individus de se plier à des conditions de travail inadaptées ou délétères, mais bien aux postes de travail, aux rythmes, aux organisations de s’ajuster aux capacités, à la santé et aux parcours des femmes et des hommes qui travaillent. C’est dans ce renversement de perspective que réside la clé d’un véritable progrès social.
Sortir de l’angle mort : les risques organisationnels
Trop longtemps, la prévention a été réduite à des aspects techniques ou individuels. Mais il est temps de regarder en face ce que les travailleurs vivent au quotidien : une organisation du travail pathogène peut peut tuer, user, briser ! Ce ne sont pas des mots en l’air. Ce sont des réalités humaines, palpables, documentées. C’est pourquoi la CFTC préfère parler de risques liés à l’organisation du travail, plutôt que de se limiter au terme « risques psychosociaux », souvent vidé de sa portée transformatrice.
Les effets délétères d’un mauvais management ou d’une organisation déshumanisante sont désormais reconnus par la loi. Mais sur le terrain, la situation s’aggrave : les arrêts maladie augmentent, la santé mentale se fragilise, les tensions se multiplient. Les managers intermédiaires eux-mêmes sont en souffrance, souvent isolés entre les exigences de résultats et le manque de soutien. L’IGAS le souligne sans détour : il est urgent de transformer nos pratiques managériales, de repenser la formation des encadrants et de renforcer leur accompagnement pour répondre aux défis du travail d’aujourd’hui et de demain. Ce constat rejoint ce que la CFTC porte depuis longtemps : la nécessité de changer d’approche, en profondeur, pour que le travail ne soit plus un facteur de mal-être mais un levier d’épanouissement.
Construire une culture du travail soutenable
Changer d’approche, c’est aussi cesser de considérer la prévention comme une simple obligation administrative. Il s’agit de bâtir une culture commune, vivante et partagée de la santé au travail. Une culture qui place la soutenabilité du travail au centre, c’est-à-dire la capacité pour chacun de tenir dans la durée, sans y laisser sa santé, sa motivation, ou sa dignité.
Cela suppose des actes concrets : repenser l’organisation du travail pour prévenir les risques en amont, et redonner aux représentants du personnel les moyens réels d’agir, d’alerter et de construire. La CFTC demande à ce titre le rétablissement des CHSCT, avec leurs prérogatives et leur autonomie, en lieu et place des CSSCT actuelles, affaiblies dans leurs moyens et leur autonomie depuis la réforme de 2017. Si l’on veut que la prévention soit prise au sérieux, elle doit redevenir un véritable pouvoir d’agir.
La santé mentale a été déclarée grande cause nationale. Mais que faisons-nous concrètement ? Les alertes sont nombreuses, les connaissances disponibles, les retours d’expérience riches. Ce qui manque, ce n’est pas le diagnostic : c’est la volonté politique, la cohérence des décisions, et surtout le passage à l’action. Il est temps de transformer les constats en actes. Cela implique aussi de reconnaître pleinement les risques organisationnels dans les indicateurs, les tableaux et les politiques publiques. Il est temps de sortir du déni collectif.
Valoriser les outils existants, repenser la gouvernance
Au cours de cette Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, un bilan a été dressé sur la mise en œuvre de l’ANI de 2020. Si certaines avancées sont à saluer, la CFTC a également pointé des insuffisances majeures. À commencer par le DUERP. Cet outil devrait être central dans toute stratégie de prévention. Pourtant, il reste trop souvent perçu comme une simple obligation administrative. Sa dématérialisation, bien qu’actée, n’est toujours pas accessible. Pour la CFTC, le DUERP doit devenir un levier stratégique, utilisé pour mieux comprendre les risques, les anticiper, et améliorer la qualité de vie au travail.
Les SPST ont également un rôle crucial à jouer. Mais ils doivent évoluer : devenir de véritables partenaires de terrain, au service des entreprises et des travailleurs. Ils doivent accompagner, former, conseiller, être moteurs d’une culture de prévention. Les nouvelles technologies, et notamment l’intelligence artificielle, peuvent être mises au service de ces objectifs, à condition qu’elles soient conçues pour et avec les travailleurs.
Enfin, la question de la gouvernance est devenue incontournable. Aujourd’hui, la santé au travail souffre d’un pilotage morcelé, d’un empilement d’acteurs et d’un manque de cohérence globale. La CFTC ainsi que l’ensemble des partenaires sociaux proposent de transformer la Commission AT/MP en un véritable conseil autonome, doté d’une mission claire, de moyens humains et financiers adaptés, capable de piloter une politique ambitieuse, nationale et cohérente.
Travailler sans s’abîmer : une ambition collective
La CFTC n’est pas venue pour faire de la figuration. Elle est venue, comme toujours, pour construire, pour porter la voix des travailleurs, pour rappeler que le travail ne doit pas être un facteur de souffrance, mais un lieu d’épanouissement, de fierté, de lien social. Nous devons sortir des logiques court-termistes, des silos institutionnels, des discours creux. Nous devons bâtir, ensemble, un avenir où travailler n’abîme plus.
« Nous ne sommes pas là pour faire semblant. Nous sommes là pour construire un avenir où travailler rime avec bien-être et fierté. »
Un appel à la cohérence et au courage politique
La Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail, commémorée le 28 avril, doit être au cœur de nos actions tout au long de l’année, et non un simple rendez-vous de communication institutionnelle. Elle doit marquer un tournant. La prévention, la soutenabilité du travail, la reconnaissance des risques organisationnels, le renforcement du dialogue social et la refondation de la gouvernance sont autant de chantiers urgents, identifiés de longue date. Ce qu’il faut désormais, c’est une volonté politique claire, partagée, et durable.
La CFTC en appelle à l’ensemble des décideurs, des employeurs et des institutions : ne vous contentez pas de constats. Engagez-vous. Donnez à la prévention les moyens, le sens et la place qu’elle mérite. Car un travail qui protège, c’est un travail qui construit. Et c’est à cette condition que nous redonnerons du souffle au monde du travail !
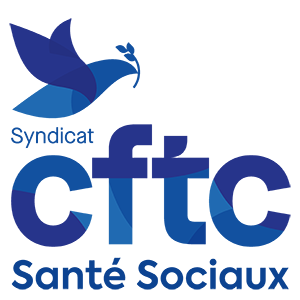

















Commentaires
Pas de commentaire.